«Ne jamais rien faire d'autre que de raconter une histoire.»

----------------------------------------------------------------------------------------
Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais du roman atypique de Christoph Ransmayr, "les montagnes volantes" ; un de ses autres romans (le troisième) écrit bien plus tôt et tout aussi déroutant est tout aussi majestueux : Le syndrome de Kitahara (prix Aristeion 1996 - ex aequo avec Salman Rushdie). Après avoir été chroniqueur culturel, depuis 1982 il ne fait plus qu’écrire et ces romans sont malheureusement bien trop rares.
La Quatrième de couverture dit :
« Deux morts gisaient noirs, en janvier, au Brésil. Un feu qui bondissait depuis des jours à travers une île sauvage, laissant derrière lui des laies carbonisées, avait libéré les cadavres d'un entrelacs de lianes fleuries, dévoilant également des blessures sous les vêtements brûlés : c'étaient deux hommes à l'ombre d'une saillie rocheuse. Ils étaient étendus, invraisemblablement désarticulés, à quelques mètres de distance seulement, entre des tiges de fougères. Une corde rouge qui les reliait l'un à l'autre se consumait dans la braise. »
Fascinant, flamboyant, hors du temps, Le Syndrome de Kitahara, qui renvoie sans cesse au passé halluciné des crimes nazis, s'inscrit dans l'ère mythique de l'éternel recommencement des guerres et des paix planétaires. Laissant filtrer les lueurs fantasmagoriques d'un véritable crépuscule des dieux, ce roman — Prix européen de littérature (Aristeion 1996) — marque l'apogée de l'oeuvre littéraire entreprise par Christoph Ransmayr avec Les Effrois de la glace et des ténèbres (1984) et Le Dernier des mondes (1988). Sans doute le plus grand livre de la littérature allemande depuis Le Tambour de Günter Grass.
--------------------------------------------------------
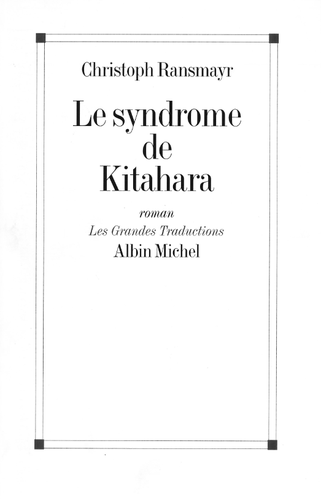
Comme j'ai souvent du mal pour parler des romans que j'ai aimés, et particulièrement de celui-ci, mélange de guerre post-apocalyptique et d'uchronie ; les destins de trois personnages bien distincts mais bien réunis par un destin commun et funeste pour deux d'entre eux ; je préfère vous livrer ici quelques lectures trouvées sur le net ; que les vols de ces critiques et mots me soient pardonnés... Bonne lecture again !
" Ici reposent onze mille neuf cent soixante-treize morts, tués par les natifs de ce pays. Bienvenue à Moor. " Dans le monde dévasté où nous jette ce roman visionnaire, apocalyptique, règne une pax americana imposée par les bombes et les humiliations. Parce que leur village fut un lieu d'extermination nazie, les habitants de Moor expient éternellement, contraints à mimer chaque année des crimes qu'ils ne veulent pas reconnaître, uniquement préoccupés de survivre. Bering, le forgeron, né sous les bombardements, est l'un d'entre eux. Il s'est pris d'un étrange attachement pour Ambras, un ancien déporté, un vainqueur, certes, mais brisé par des souvenirs atroces. Ces deux errants n'ont d'autre choix que de reconstruire quelque chose qui ressemble à un ordre social. Mais une paix ainsi imposée peut-elle engendrer autre chose que le désir de vengeance et de guerre ? On a pu comparer au Tambour, de Günter Grass, cette œuvre où les tragédies de l'histoire se surimpriment, à chaque page, aux visions d'un monde futur, soumis au nom du bien à un tyrannique juge suprême du nom de Stellamour. Après Le Dernier des mondes, cette nouvelle œuvre confirme la place de premier plan de son auteur, un Autrichien né en 1954, dans la jeune littérature européenne.
Après la Seconde Guerre mondiale, mais qui aurait duré trente ans, dans un cadre dévasté en dégradation constante, trois destins s'affrontent. Roman onirique et métaphorique aux personnages archétypiques.
Par GAUDEMAR Antoine de
Le «syndrome de Kitahara», qui donne son titre au troisième roman
traduit de l'Autrichien Christoph Ransmayr, serait une affection oculaire provoquant des taches plus ou moins envahissantes dans la vision: une sorte de «trou dans l'oeil», imaginé par l'écrivain et touchant des soldats épuisés par l'affût, des vigiles épuisés par leur veille, mais aussi des gens aveuglés par la haine. S'ils survivent, ces malades deviennent rarement aveugles, il suffit que la tension baisse et avec le temps, ils recouvrent peu à peu l'intégralité de leur vue. Le jeune Bering, le héros du roman de Christoph Ransmayr, souffre de ce syndrome. Il a de quoi. C'est un enfant de la guerre, né après les combats mais dans un pays comme «retombé à l'âge des volcans»: «La nuit, le pays flamboyait sous un ciel rouge. Le jour, des nuages de phosphore aveuglaient le soleil et, dans des déserts de gravats, des hommes sortis de leurs cavernes chassaient pigeons, lézards et rats. Il tombait des pluies de cendres.» Dans ces contrées ravagées répondant au sinistre nom de Moor, les rescapés réapprennent à vivre dans l'expiation alors que les six armées victorieuses font de ce bout du monde leur terrain d'occupation et d'expérimentation favori. Au milieu de ce tohu-bohu, Bering n'a qu'un rêve: devenir un oiseau, s'envoler. Des années plus tard, avec son maître et une belle Brésilienne, il réussira à s'extirper de son cauchemar quotidien, et à partir de l'autre côté de l'océan, vers le Brésil de tous les mirages, où l'attend son destin.
Comme les précédents romans de l'auteur (le Dernier des mondes, les Effrois de la glace et des ténèbres), le Syndrome de Kitahara peut se lire comme une fable sombre et lyrique, aux accents apocalyptiques, sur la vieille Europe centrale et ses démons. Le monde crépusculaire et néo-concentrationnaire de Moor est d'inspiration fantastique mais parfaitement plausible: issu tout droit des horreurs du nazisme, il propose une vision mythique et sans espoir de l'Histoire, en proie à des forces maléfiques dont l'homme est l'incessante victime. Avec un souffle certain, parfois démonstratif, l'auteur semble craindre le retour des pires abominations, comme si les hommes, à l'image de son héros innocent et tragique, avaient encore le regard - et la mémoire - obscurcis par trop d'inquiétantes taches noires.
Né en Haute-Autriche en 1954, fils d'instituteur de village, propulsé vers le succès dès son coup d'essai (le Dernier des mondes, traduit en vingt-six langues), Christoph Ransmayr a fait des études de philosophie et d'ethnologie à Vienne, avant de se lancer par hasard dans le journalisme: essentiellement des reportages issus de ses voyages aux quatre coins du monde, du Spitzberg au Népal. «Ce sont ces voyages qui ont nourri ma veine narratrice», expliquait-il lors d'un récent passage éclair à Paris. «J'ai beaucoup marché sur chaque continent, surtout en Asie, car le rythme de la marche est celui qui convient le mieux au narrateur d'histoires. La plupart du temps, je ne comprenais rien à la langue mais la marche me faisait tout oeil et tout ouïe. A mon retour, longtemps après, le voyage commençait à parler en moi. Cette expérience est devenue, presque à mon insu, le sens de ma vie. C'est comme si je renouais avec un besoin archaïque, celui du conteur. Seule la lecture à haute voix, seul ou devant un petit cercle d'amis, me donne l'assurance et l'énergie nécessaires à la poursuite de mes entreprises. Mais, bien qu'indissociables, le monde réel et celui de l'imaginaire ne sont pas identiques. La guerre à Moor n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, le camp de Moor n'est pas Auschwitz, même si le récit ne peut naître qu'à partir d'une certaine expérience du monde. En revanche, j'ai nommé le Brésil, car pour beaucoup d'Européens comme moi, c'est un lieu mythique, d'utopie fabuleuse, et de tous les paradoxes: où voit-on mieux qu'au coeur de ce paradis - où se sont enfuis victimes et bourreaux de l'Holocauste -, la violence de la pauvreté, l'épuisement des ressources et des paysages, l'invraisemblable répartition des richesses? En ce sens, le Brésil est le pays de l'écriture et je ne serais pas ici si je ne pouvais y partir à tout instant.»
Ils ressemblent à ceux de la rive la plus rude du lac de Traunsee. C'est là qu'on trouve les carrières d'Ebensee.
Un jour, alors que l'enfant avait 10 ans, son père amène la classe en excursion dans ces carrières. Ils traversent le lac aux eaux claires. De l'autre côté, il raconte aux enfants l'histoire d'Ebensee. «Ce fut l'un des pires camps de travail nazi, dit Ransmayr. On fit construire aux prisonniers d'immenses tunnels pour y cacher les fusées de Von Braun, ce criminel. Elles n'arrivèrent jamais. Ce n'était pas un camp d'extermination, mais le taux de mortalité était supérieur à celui d'Auschwitz.» En 1995, Ransmayr publie le Syndrome de Kitahara. Le roman s'inspire du camp d'Ebensee. Le village de Moor est occupé par les libérateurs. L'officier américain oblige les habitants à reproduire les cérémonies du camp, dans le rôle des victimes, mais en leur donnant des habits et des couvertures. Il les fait maçonner et crépir sur les parois des lettres «au garde-à-vous dans la carrière, grandes, grossières, recouvertes d'un crépi blanc, des lettres visibles de loin, au garde-à-vous comme les soldats disparus de Moor, au garde-à-vous comme les colonnes de prisonniers à l'appel, comme les vainqueurs sous leurs étendards levés en signe de triomphe». Et comme les bannières tibétaines dans les vallées perdues. Le roman est dédié au père de Ransmayr, mort juste avant sa publication. L'autre dédicataire est le premier éditeur américain des livres de Ransmayr. Le père de cet éditeur était un Juif viennois. En fuyant les nazis, il jura de ne plus jamais prononcer un mot d'allemand. L'éditeur arpenta Vienne pour la première fois en compagnie de Ransmayr. Il s'appelle Fred Jordan, mais l'écrivain a dédié le roman à son nom autrichien, Fred Rotblatt. Ransmayr écrit souvent dans un petit chalet isolé, au sommet d'une montagne dominant le lac de Traunsee. La littérature est un pays lointain.
Antoine de Gaudemar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autre magnifique analyse trouvée sur le net de Joël Vincent :
Pour l'exemple, à Matthausen, en février 1945, ajoute Menasse, cinq cents prisonniers qui tentaient de s'évader ont presque tous été assassinés par des riverains...
*
* *
C'est précisément à côté de ce camp de concentration que Ransmayr situe le lieu de son dernier roman, Le Syndrome de Kitahara. Près des carrières de granit exploitées par les détenus, le village de Moor, après la défaite, subit la présence des troupes américaines. La population, pleine de ressentiment, humiliée et rageuse, se voit contrainte de «singer» le travail des anciens détenus et de participer à des pélerinages, placés sous le signe de l'expiation, organisés par les américains. Et cela alors que les marques de la civilisation refluent tout autour : retour à la bougie, aux coquelicots qui envahissent tout, aux bandes armées, aux meutes de chiens errants ; on est presque à l'âge de pierre, dans une sorte de nulle part, de ìrienî qu'un critique a nommé le «monde pétrifié».
Face à ce monde qui vient de s'effondrer, ó monde des camps, des meurtres massifs et programmés, de la bombe atomique ó tout l'art de Ransmayr est de contourner cet univers et de présenter une réalité insoutenable par le biais d'un récit allégorique.
Le premier personnage du roman est Bering, dont le père, qui a fait la campagne de Libye, est devenu une véritable loque humaine. Né sous un bombardement, Bering passe les premiers mois de sa vie dans le noir, au milieu des poules caquetantes. Il se sent presque oiseau. Le martèlement de la forge, l'obsession de la lumière émanant du poste à souder, font de lui un être d'une grande acuité sonore et rêvant d'objets de lumière arrachés à l'obscurité. Peu à peu s'installent en lui des marques de pouvoir : une vieille voiture américaine, une Studebaker, passée entre ses mains, prend la forme d'un oiseau, elle devient la ìCorneilleî ; il maîtrise la meute de chiens ; il invente des objets métalliques... Mais ses épreuves surmontées ne le mènent à rien. Un trouble de la vision, un trou noir, quelque chose de morbide en tout cas, l'empêche d'accomoder les formes du réel. Quand il fait trop d'effort pour essayer de mieux voir, le trou noir s'élargit : la réalité n'est pas élucidable. Il est atteint de la maladie de Kitahara, d'après le nom d'un médecin japonais qui a décelé chez certains de ses contemporains la présence de formes mouvantes, d'intumescences, dans l'oeil. Même s'il entrevoit parfois le début d'une nouvelle humanité, notamment dans ses relations avec Lily, cela devient vite un rêve impossible. Ne pouvant donc percer l'opacité des choses, il vit entre deux mondes, à un niveau infra-conscient, ressassant compulsivement des images archaïques de masses flottantes, de désirs d'oiseaux, qui le ramènent à son origine. Peut-être est-ce alors au lecteur de poursuivre ce parcours initiatique, et de degré en degré, de manifester l'existence de quelque chose qu'on appelle la ìconscienceî ?
Le second personnage du livre est Ambras, chez qui le temps s'est figé le jour où l'on a arrêté sa compagne juive. Déporté à la carrière pendant la guerre, il vit maintenant, insaisissable, lointain, peu sensible à ce qui est humain, au milieu d'une meute de chiens. En observant des inclusions organiques, images secrètes, intemporelles du monde, sorte d'ambre refermant des insectes englués, on dirait qu'il remonte le temps, à la recherche d'une pureté originelle. Ambras perçoit encore l'odeur des fours, des morts qui partent en fumée. Il a des visions de sang. Il se sent déjà mort, comme ìcouléî dans la carrière.
Enfin il y a Lily, la chasseresse, hautaine et solitaire, au passé de souffrances (son père, un officier SS, a été reconnu et pendu par d'anciens détenus) qui apparaît aux habitants comme une princesse païenne, sortie d'une Bible d'images : peut-être incarne-t-elle Lilith, la première Ève. Elle seule rêve encore à un avenir possible, en regardant souvent une vieille carte du Brésil, en espérant dans cet ailleurs exotique.
En passant d'une réalité à une autre, des montagnes aux basses-terres, le récit de Ransmayr entre dans un temps différent. Dans la plaine, occupée aussi par les américains, ce sont les lumières trop aveuglantes de la ville, la grande consommation, l'opulence, la vitrine électronique qui présente le monde sous la forme de l'illusionnisme : sur les écrans les événements sont édulcorés, nivellés ; le champignon atomique de Nagoya est devenu un spectacle comme le reste, alors pourquoi ne pas le reculer de vingt ans ?
Bering, Ambras, Lily, comme des ombres fantomatiques, fuient vers une autre terre, le Brésil. Ils y découvrent d'anciens camps, des traces de souffrances vécues par d'autres. Partout où l'on va, le fil invisible du destin paraît conduire aux mêmes cataclysmes. Le monde est un abîme sans fond, sans espoir d'horizon. Peut-être pour Lily, qui regarde ailleurs, reste-t-il une lueur dans la vision tragique de l'écrivain ? Ransmayr semble en effet nous ramener toujours aux mêmes questions : pourquoi il y a-t-il des camps ? des crématoires ? le secret se cache-t-il dans les zones obscures du champ visuel de Bering, dans son monde troué ?
* *
*
L'écrivain ne peut pas tenir tous les fils de sa propre histoire. La littérature est pour lui un détour, une fiction heuristique, aidant à comprendre ce que nous vivons. En sachant bien, que le langage reste quelque chose de fragile, et, comme le dit Pascal Quignard, qu'il «n'est pas inné en nous, que nous l'avons acquis et que nous pouvons le perdre, que la pensée est presque une musculation physique». La littérature a donc pour tâche d'élucider, si possible, les points de rupture de la raison, là où celle-ci n'entretient plus le dialogue nécessaire avec la nature et ses métamorphoses, mais se travestit en vérité unique, en folie meurtrière, ou bien s'allie avec des forces irrationnelles ou avec la plus simple bêtise. Ainsi pour Ransmayr, l'humain est encore à venir.
Joël Vincent

















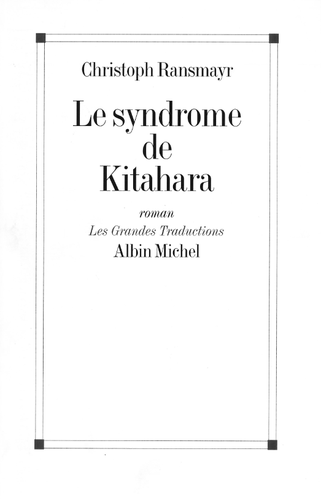













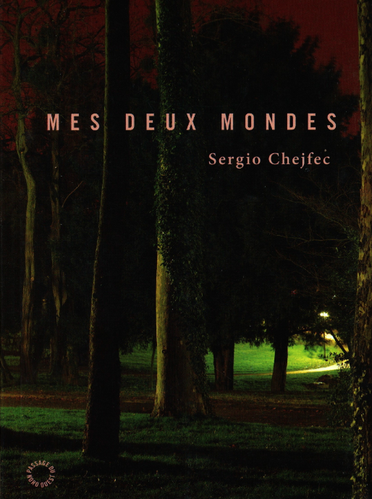

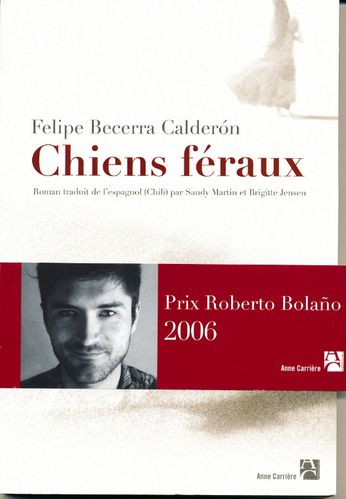
 « L’arrangement »
« L’arrangement »







/idata%2F0218007%2Fmes-photographies%2Fvenise.jpg)